Énigme de l'Altérité : Entre Projection Imaginaire et Confrontation au Réel de l'Autre
- pmartinpsy
- 20 mai
- 10 min de lecture
Vignette Clinique : L'Énigme de l'Immobilité et la Confrontation au Réel de l'Autre

« Ce matin je me suis fait la remarque, quand un jeune homme alors qu’ils étaient trois, le gamin n’a pas bougé et ça m’a énervé. Je me suis dit à ce moment-là que je n’étais pas indifférent. Donc que je partais du principe que nous avions tous un même niveau d’éducation mais que c’est imaginaire. À ce moment-là je me suis dit que si je suis un parmi d’autre, une éducation parmi d’autre. Et que j’étais bloqué parce que je pars du principe que mon éducation et mieux que celle de l’autre. Dans les faits elle l’est puisque la mienne prend en compte qu’il faut respecter les gens. »
Attention
Il est crucial d'aborder la lecture de cette vignette clinique avec prudence et discernement. Elle offre un éclairage singulier sur une dynamique psychique spécifique et peut s'avérer un outil heuristique précieux pour décrypter d'autres situations cliniques. Cependant, de par son caractère unique et contextuel, elle ne saurait être érigée en modèle universel. La complexité de la psyché humaine et la singularité de chaque trajectoire subjective impliquent qu'il existe potentiellement une infinité de contre-exemples. Cette vignette invite à la réflexion et à l'ouverture clinique, mais ne saurait en aucun cas se substituer à une analyse approfondie et individualisée de chaque situation rencontrée. D’ailleurs ici, il s’agit en réalité de deux vignettes rassemblées en une. Consentement éclairé accordé.
Ce matin-là, une scène apparemment banale avait captivé l'attention de Monsieur D. Au sein d'un groupe de trois jeunes, l'immobilité singulière de l'un d'eux avait suscité chez lui une réaction d'irritation notable. Cet énervement avait rapidement conduit Monsieur D. à une introspection. Il prenait conscience de son implication émotionnelle face à cette situation et de la projection sous-jacente d'une homogénéité éducative qu'il reconnaissait intellectuellement comme illusoire.
Cette observation initiale avait amorcé une réflexion plus profonde sur son propre positionnement subjectif. La remise en question de la supériorité de son propre système de valeurs, bien qu'intellectuellement admise (« si je suis un parmi d’autre, une éducation parmi d’autre »), se heurtait à un sentiment persistant de blocage dans ses interactions sociales. Monsieur D. reconnaissait fonctionner selon un postulat implicite de la supériorité de son éducation, notamment en ce qui concernait l'impératif du respect.

L'origine de cette colère avait ensuite été associée par Monsieur D. à une sentence répétée de son beau-père : « Si tu peux le faire tout le monde peut le faire. » Cette affirmation, longtemps perçue comme une négation de sa singularité, avait progressivement révélé sa nature aliénante. Monsieur D. en était venu à considérer que « un parmi d'autres » ne signifiait pas une dilution dans la masse, mais plutôt une distribution singulière d'aptitudes. L'immobilité de l'adolescent était alors réinterprétée non seulement comme un manque de savoir-vivre, mais comme l’absence d'une compétence que Monsieur D. avait dû développer comme une stratégie de survie : une attention constante à l'Autre.
Cette colère, analysait Monsieur D., pouvait être appréhendée comme un symptôme, une manifestation de la difficulté à accepter le Réel de l'Autre dans son altérité irréductible, ça mérite une explication :
Le Réel : Chez Lacan, il n'est pas la réalité empirique que nous percevons. Il s'agit d'un ordre radicalement extérieur au symbolique et à l'imaginaire. C'est ce qui résiste à toute symbolisation, à toute mise en mots, à toute image. C'est un trou, un impossible, un noyau dur et traumatique autour duquel s'organisent nos représentations. Pensez à ce qui échappe toujours, ce qui bute, ce qui fait symptôme. C'est l'os de la réalité, impossible à digérer complètement par le langage.
L'Autre (avec un grand A) : L'Autre, dans la théorie lacanienne, n'est pas simplement l'autre individu. Il désigne l'ordre symbolique lui-même, le trésor des signifiants, le lieu du langage, des lois, des conventions sociales et culturelles qui nous précèdent et nous structurent. C'est le grand Autre qui nous assigne une place, qui nous parle à travers le langage et la culture. C'est en quelque sorte le « scénario » dans lequel nous jouons notre existence ou pour les informaticiens le code ex : Javascript.
Son altérité irréductible : C'est ici que réside le nœud de la formule. L'altérité de l'Autre signifie sa radicale différence, son extériorité fondamentale par rapport au sujet. Cet Autre n'est pas une simple projection de notre psyché, ni un alter ego compréhensible et maîtrisable (en psychanalyse petit autre). Il est fondamentalement Autre, étranger.
L'adjectif "irréductible" vient renforcer cette idée. Cette altérité n'est pas quelque chose que l'on peut gommer, apprivoiser ou réduire à notre propre entendement. Il y a un noyau de l'Autre qui nous échappe nécessairement, une part qui reste opaque, non-symbolisable. C'est précisément ce point de résistance, ce réel de l'Autre, qui constitue son altérité irréductible. Le On n’existe pas et n’existera jamais dans un couple par exemple, et nous ne comprendrons jamais l’Autre parce que nous ne serons jamais ce qu’il a la tête. « Je ne te reconnais plus » est une hérésie parce que nous n’avons jamais vraiment connu cet Autre.
Ensemble, la phrase signifie que :
Au cœur de cet ordre symbolique qui nous constitue (l'Autre), il existe un noyau réel, une part qui échappe fondamentalement à notre capacité de symbolisation et de compréhension. Cette part n'est pas une simple absence ou un manque que l'on pourrait combler par plus de langage ou de connaissance. Elle est constitutive de l'Autre lui-même et demeure radicalement autre, étrangère au sujet.
Implications cliniques et théoriques :
Cette formulation a des implications majeures en clinique. Elle souligne que :
La relation à l'Autre est toujours marquée par un impossible : Il y a toujours une part de l'Autre qui nous échappe, un désir de l'Autre que nous ne pouvons entièrement saisir.
Le symptôme peut être une tentative de réponse à ce réel de l'Autre : Face à cet impossible à symboliser, le sujet peut construire des formations symptomatiques pour tenter de donner un sens à ce qui lui échappe.
La cure analytique ne vise pas à une transparence illusoire avec l'Autre : Il s'agit plutôt d'apprendre à composer avec cette altérité irréductible, à subjectiver le manque et la castration liés à cette rencontre avec le réel de l'Autre.
En somme, "le réel de l'Autre dans son altérité irréductible" pointe vers la rencontre fondamentale et toujours partielle du sujet avec l'ordre symbolique qui le précède et le constitue, une rencontre marquée par un noyau réel insaisissable et entièrement autre. C'est un rappel constant de la limite de la symbolisation et de l'étrangeté constitutive de notre rapport au langage et à l'Autre.
Les réactions des autres, souvent décalées par rapport à ses propres attentes et à sa compréhension du monde, venaient buter contre ses tentatives de symbolisation. La conscience de l'impossibilité d'une compréhension totale de l'Autre s'était imposée à lui, une limite qu'il ne pensait pouvoir approcher qu'en partie.
Dans ce contexte, la formule sartrienne « L'enfer, c'est les autres » avait pris pour Monsieur D. une résonance particulière. L'Autre, dans son énigme et son altérité, apparaissait comme une possible manifestation du Réel, ce qui échappe à la pleine symbolisation et à la maîtrise cognitive. La tentative incessante de comprendre l'Autre, souvent vouée à l'échec, pouvait engendrer une forme de souffrance et de frustration.
Monsieur D. avait fini par entendre et considérer le signifiant « enfer » comme porteur d'une équivoque colorée : « en-faire avec l'autre », soulignant la complexité et les conflits inhérents aux relations interhumaines, ou encore « quoi en-faire de l'autre », révélant la tentative vaine de réduire l'altérité à un objet de connaissance et de contrôle. Cette lecture subjective éclairait sa propre expérience relationnelle, marquée par une quête de sens face à l'opacité de l'Autre. Son « enfer » personnel semble se situer dans cette tension constante entre le désir de connexion et la frustration face à l'énigme irréductible de l'Autre.
Pour réfléchir :
La vignette clinique de Monsieur D. offre un éclairage précieux sur la complexité des dynamiques intersubjectives et la manière dont nos projections imaginaires et nos tentatives de symbolisation se heurtent inévitablement au Réel énigmatique de l'Autre. Son observation initiale, apparemment anodine grâce à l’association libre, de l'immobilité d'un adolescent au sein d'un groupe, déclenche une cascade de réflexions qui révèlent des couches profondes de son propre fonctionnement psychique, oscillant entre des idéaux imaginaires, des croyances symboliques et la confrontation parfois irritante avec l'altérité.
L'énervement de Monsieur D. face à l'immobilité de l'adolescent met en évidence une attente implicite d'une certaine forme d'engagement ou de participation au sein d'un groupe. Cette attente semble ancrée dans une projection imaginaire d'un « niveau d'éducation uniforme », une croyance en un socle commun de compréhension et de comportement vis-à-vis du monde. La reconnaissance lucide de la nature imaginaire de cette attente constitue un premier pas vers une déconstruction de ses propres biais perceptifs.
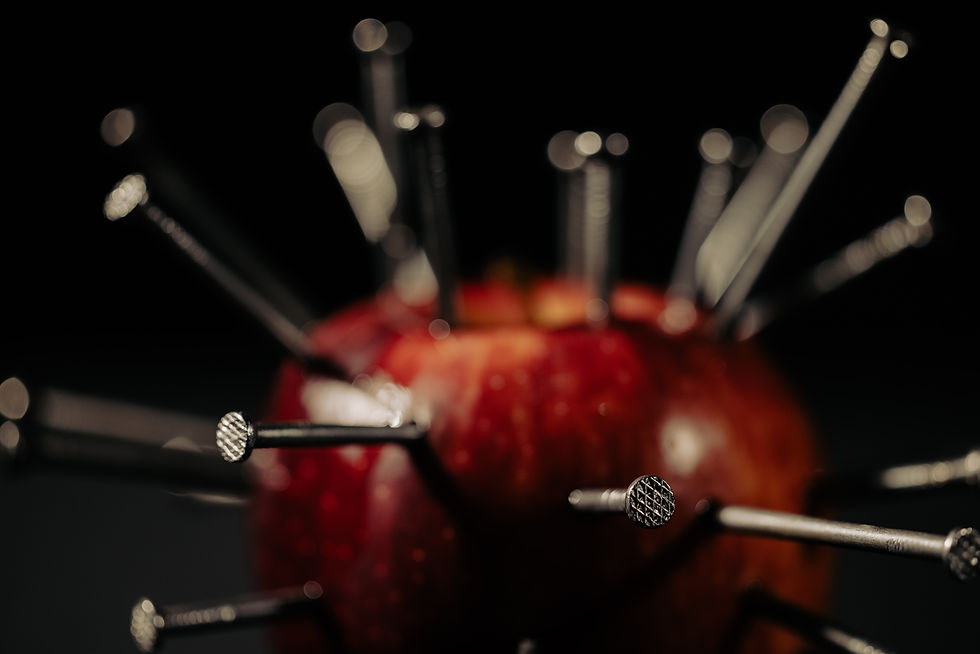
La remise en question de la supériorité de sa propre éducation témoigne d'une ouverture à la relativité des systèmes de valeurs. Cependant, la persistance d'un sentiment de blocage dans ses interactions suggère une tension entre cette reconnaissance intellectuelle et une adhésion émotionnelle plus profonde à ses propres normes. La valeur fondamentale du respect, érigée en critère de supériorité éducative, révèle un pilier éthique central pour Monsieur D., mais souligne également le risque d'une évaluation normative des comportements d'autrui à l'aune de ses propres convictions.
L'évocation de la phrase du beau-père, « Si tu peux le faire tout le monde peut le faire », met en lumière une blessure narcissique potentielle, une négation de la singularité qui a pu influencer la manière dont Monsieur D. s'est positionné dans le monde. Sa réinterprétation tardive de « un parmi d'autres » comme une reconnaissance de la diversité des aptitudes marque une avancée vers l'affirmation de sa propre singularité et la reconnaissance de la valeur de son empathie, une qualité qu'il a développée comme une stratégie de protection face à un environnement potentiellement perçu comme menaçant quand il était enfant.
La colère ressentie face à l'adolescent ne se réduit alors pas à un simple jugement moral, mais apparaît comme une réaction à ce qui est perçu comme un manque d'une aptitude qu'il a lui-même dû acquérir par nécessité de protection et une incompréhension vis-à-vis du fait que finalement l’Autre ne l’a peut-être pas mais ne peut être pas faire ce que lui fait . Cette colère devient un symptôme, une manifestation de la difficulté à accepter le Réel de l'Autre dans sa différence et son opacité. L'Autre, par ses réactions inattendues et son décalage par rapport aux attentes de Monsieur D., incarne cette dimension du Réel qui échappe à la pleine symbolisation et à l'emprise de l'imaginaire. Il fallait déplacer son regard de la scène pour envisager le monde sous un nouvelle angle.

Son interprétation du signifiant « enfer » comme une équivoque avec « en faire avec l'autre » ou « quoi en faire de l'autre » ouvre une perspective riche sur la dimension intersubjective de la souffrance et sur la tentative vaine de réduire l'altérité à une catégorie maîtrisable. En conclusion, le cheminement de Monsieur D., de l'irritation initiale à une réflexion plus profonde sur la nature de ses attentes et de ses réactions face à l'altérité, met en lumière la complexité du rapport au Réel de l'Autre. Son expérience souligne la tension inhérente à la rencontre intersubjective, où nos constructions imaginaires et nos cadres symboliques sont constamment mis à l'épreuve par la singularité irréductible de l'autre, cette part d'ombre qui résiste à notre désir de compréhension totale. Son exploration du signifiant « enfer » comme une modalité d'"en faire avec l'autre" ou de questionnement sur « quoi en faire de l'autre » révèle une quête de sens face à cette énigme constitutive de la condition humaine.
Bibliographie
· Adam, J. (2011). De l’inquiétante étrangeté chez Freud et chez Lacan. Champ lacanien, 10 (2), 195-210. doi : 10.3917/chla.010.0195.
· Chaboudez, G. (2002) . L'auto-érotisme de la jouissance phallique. Essaim, no10(2), 35-48. https://doi.org/10.3917/ess.010.0035.
· Chaboudez, G. (2022) . Sexuation, sublimation. Figures de la psychanalyse, n° 43(1), 63-76. https://doi.org/10.3917/fp.043.0063.
· Chaboudez, G. (2007) . Le temps logique de l'adolescence. Adolescence, T. 25 n°2(2), 373-383. https://doi.org/10.3917/ado.060.0373.
· Chaboudez, G. (2008) . La réalité sexuelle. Che vuoi ? N° 29(1), 95-109. https://doi.org/10.3917/chev.029.0095.
· Chaboudez, G. (2017) . La traversée du masculin. La clinique lacanienne, n° 29(1), 31-48. https://doi.org/10.3917/cla.029.0031.
· Chaboudez, G. (2017) . Séparation du sexe et de l’amour. Tiers, N° 20(2), 93-105. https://shs.cairn.info/revue-tiers-2017-2-page-93?lang=fr.
· Cléro, J.-P. (2008) « dictionnaire Lacan », Ellipses
· Cléro, J. (2003). Concepts lacaniens. Cités, 16 (4), 145-158. doi : 10.3917/cite.016.0145.
· Cottet, S. (1987) « je pense où je ne suis pas, je suis où je ne pense pas », bordas, p.13-29
· Dor, J. (2002) « introduction à la lecture de Lacan », DENOEL
· Freud S. (1900), L’interprétation des rêves, Presses Universitaires de France, 1999
· Freud S. (1907), Le délire et les rêves dans la Gradiva de W.Jensen, Gallimard, folio essais, Paris, 1986.
· Freud S. « Le moi et le ça ». In : Œuvres complètes, psychanalyse XVI : 1921-1923 (1923b). Paris : PUF, 1991, p. 255-301 (traduction française C. Baliteau, A. Bloch, J.-M. Rondeau).
· FREUD, S. (1925). « La négation », dans Résultats, idées, problèmes II, Paris, PUF, 1998.
· FREUD S. (1985) : L’inquiétante étrangeté et autres textes. Gallimard, coll. Folio Bilingue, Paris.
· FREUD S, « Au-delà du principe de plaisir » (1920), dans Essais de psychanalyse, Paris, Payot, 1981, p. 104.
· LACAN, J. (1966), « Écrits », Paris, Seuil :
LACAN, J., Le Séminaire II, « Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse », Paris, Seuil, 1978.
· LACAN, J. (19..). Le Séminaire – Livre IV
· LACAN, J. (19). Le séminaire – Livre V : les formations de l’inconscient, Paris, Le Seuil, 2004.
· LACAN, J. Le Séminaire, Livre X, L’angoisse, Paris, Seuil, 2004
· LACAN, J. (1964). Le Séminaire – Livre XI : Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Le Seuil, 1973.
· LACAN, J. (1979). « Le mythe individuel du névrosé », Revue Ornicar ? n° 17/18, Paris.
· Leger, C. (1987) « Quel est donc cet autre auquel je suis plus attaché qu’à moi ? », bordas, p 31-58
· Marin, D. (2019). De la littérature à la lettre de l’inconscient. L'en-je lacanien, 32(1), 37-58. doi:10.3917/enje.032.0037.
· Menès, M. (2014). « ... le tissu même de l'inconscient ». L'en-je lacanien, 22(1), 17-24. doi:10.3917/enje.022.0017.
· Miller, J.-A. (1966). « La suture (éléments de la logique du signifiant) », Cahiers pour l’analyse, Cercle d’épistémologie de l’École normale supérieure, vol. 1-2, janvier-février et mars-avril 1966.
· Philippe, J. (1990) Pour lire Jacques Lacan, Le retour à Freud, Paris, epel.
· Poli, M. (2005). Le concept d’aliénation en psychanalyse. Figures de la psychanalyse, no 12 (2), 45-68. doi : 10.3917/fp.012.0045.
· SOLER, C. 2009. Lacan, L’inconscient réinventé, Paris, PUF.
· Toffin, G. (2017). La fabrique de l’imaginaire. L'Homme, 221(1), 167-190. https://www.cairn.info/revue-l-homme-2017-1-page-167.htm.
コメント